En novembre 2022, le lancement de ChatGPT a décuplé l’attention du grand public pour l’intelligence artificielle (IA). Chacun s’interroge : jusqu’où l’IA peut-elle rivaliser avec l’humain, et quelles tâches pourra-t-elle accomplir dans nos entreprises ? Pour éclairer ces questions, l’OCDE a développé de nouveaux indicateurs permettant de mesurer concrètement les capacités des systèmes d’IA et de les comparer aux aptitudes humaines. Ce dossier décrypte ces indicateurs en termes simples, met en évidence les domaines où l’IA progresse le plus vite – et ceux où elle reste à la traîne – et explore comment ces évolutions pourraient transformer le travail dans les petites et moyennes entreprises (PME). À la clé : des repères clairs pour aider les dirigeants de PME à anticiper les changements à venir.
Neuf indicateurs pour mesurer les capacités de l’IA
Afin de mieux comprendre ce que les IA savent vraiment faire (ou non), l’OCDE a élaboré neuf indicateurs inspirés des grandes aptitudes humaines. Chaque indicateur correspond à un domaine de compétence et se présente comme une échelle de maturité en 5 niveaux : du niveau 1 (capacités rudimentaires, en deçà de l’humain) au niveau 5 (performance équivalente à l’humain dans les tâches les plus difficiles). Plus le niveau est élevé, plus l’aptitude est sophistiquée et difficile à atteindre pour une machine. Ce cadre a été développé sur cinq ans avec l’appui de dizaines d’experts en IA, en psychologie cognitive et d’autres domaines scientifiques, afin d’être crédible scientifiquement tout en restant accessible à un public non technique
Les 9 capacités évaluées par l’OCDE sont les suivantes :

Langage
comprendre et générer du langage (texte ou parole) de façon pertinente. Par ex. converser, répondre à des questions, traduire un texte.

Interactions sociales
percevoir des signaux sociaux et y répondre de manière appropriée dans des échanges avec des humains. Par ex. détecter l’émotion dans la voix, s’adapter au langage corporel.

Résolution de problèmes
raisonner logiquement, planifier et résoudre des tâches complexes. Par ex. résoudre une énigme, planifier un itinéraire optimal.
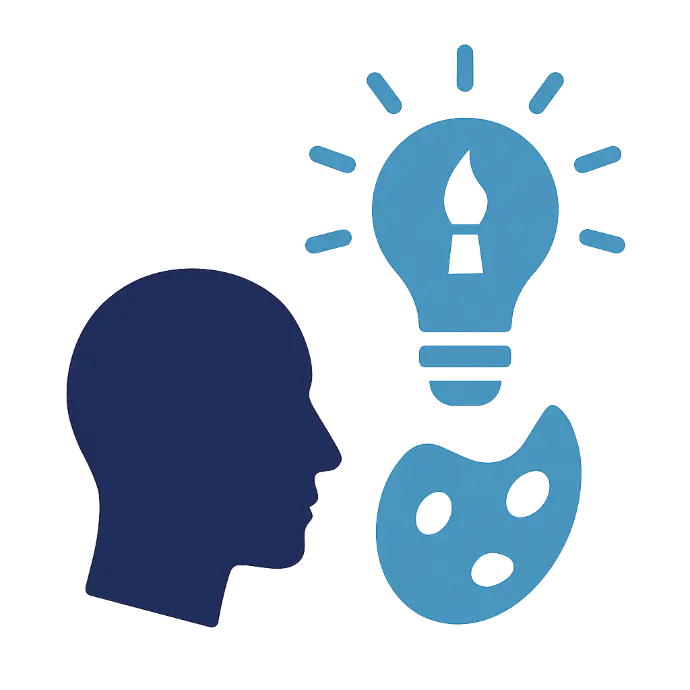
Créativité
produire des idées ou des contenus nouveaux et de qualité. Par ex. composer de la musique, proposer un design original ou une stratégie inédite.

Métacognition et esprit critique
évaluer sa propre connaissance et raisonner sur son propre raisonnement. Par ex. détecter quand on risque de se tromper, vérifier la fiabilité d’une information.
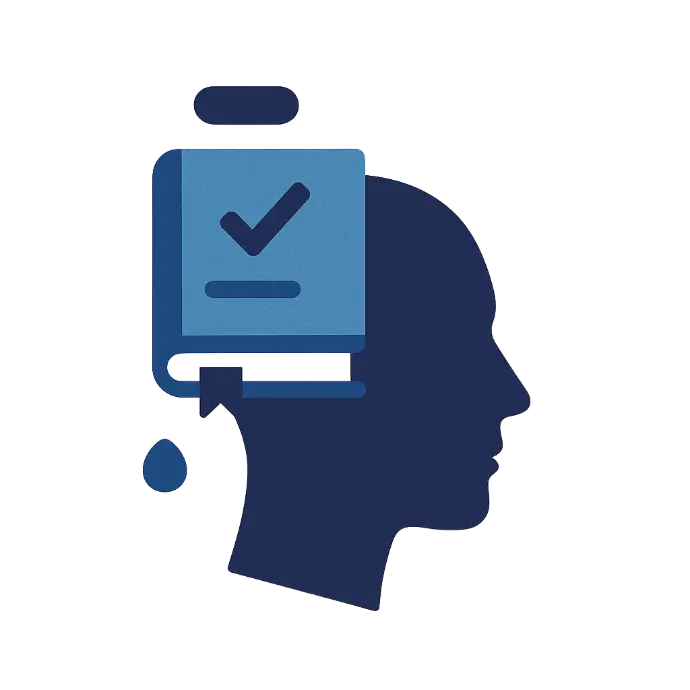
Connaissance, apprentissage et mémoire
emmagasiner des connaissances et les réutiliser, apprendre de nouvelles informations ou de l’expérience, et se souvenir sur le long terme.
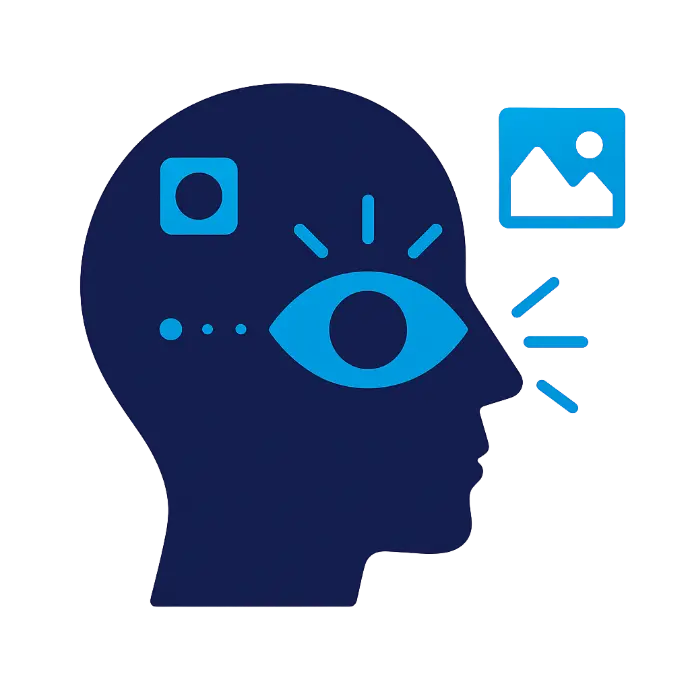
Vision
percevoir et interpréter le monde visuel. Par ex. reconnaître des objets ou des personnes sur des images, analyser une scène vidéo.
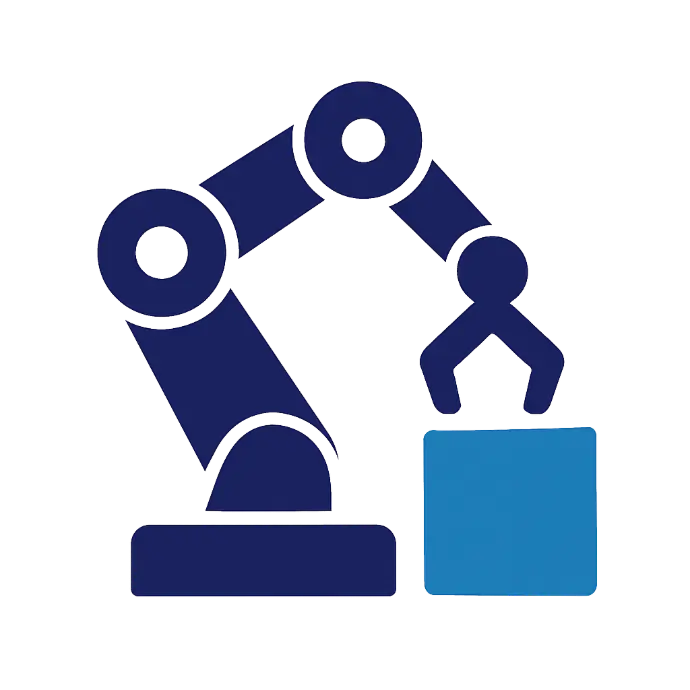
Manipulation physique
interagir avec des objets dans le monde réel, avec dextérité et adaptation. Par ex. saisir et déplacer des objets, assembler des pièces, utiliser des outils.
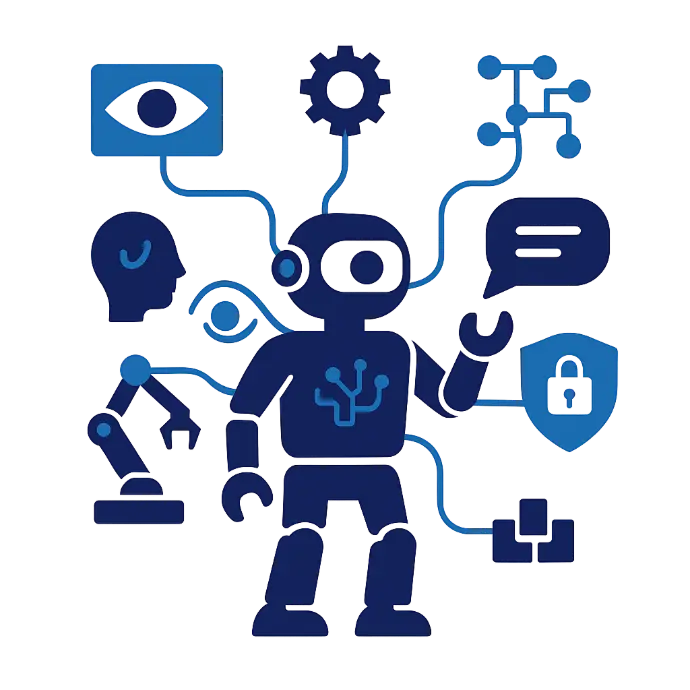
Intelligence robotique (intégration sensorimotrice)
combiner les capacités précédentes au sein d’un agent autonome dans un environnement réel. En d’autres termes, coordonner vision, mouvement, langage, etc., pour accomplir des tâches complexes dans le monde physique (comme un robot qui se déplace et prend des décisions en temps réel).
Chaque indicateur est illustré par une échelle à cinq niveaux décrivant des tâches caractéristiques que l’IA peut accomplir à ce niveau. Par exemple, pour le langage, le niveau 1 correspond à un système très basique qui ne fait que repérer des mots-clés sans véritable compréhension (typiquement un moteur de recherche rudimentaire). Au niveau 3, un système linguistique sait déjà interpréter correctement du texte et en générer de façon cohérente, en montrant une compréhension sémantique avancée et même un peu de raisonnement logique. Au niveau 5, l’IA maîtriserait le langage presque comme un humain expert : nuances de style et d’humour, apprentissage de nouvelles langues “à la volée”, connaissance du contexte en temps réel et capacité d’adaptation continue sans nouvel entraînement. De telles performances de niveau 5 restent aujourd’hui théoriques – aucun système actuel ne les atteint – mais elles fixent un horizon de référence.
L’intérêt de ces indicateurs est de fournir un langage commun pour décrire les prouesses de l’IA. Plutôt que de parler en termes vagues (« IA forte », « IA faible »...), on peut évaluer une IA sur chaque échelle. Par exemple, un assistant vocal pourra être jugé niveau 2 en langage, niveau 1 en interactions sociales, etc. C’est un outil utile pour les décideurs publics comme pour les entreprises, car il permet de comparer l’IA à l’humain sur des aptitudes bien définies, et d’identifier à quel point l’IA peut remplacer, compléter ou laisser la main à l’humain selon les tâches.
Progrès fulgurants en langage et en vision, retard dans le social et le physique
Quels enseignements tirent ces indicateurs ? Ils montrent que toutes les capacités de l’IA n’évoluent pas au même rythme. Dans certains domaines, les avancées récentes sont impressionnantes ; dans d’autres, l’IA reste très en dessous des humains. Voici un panorama des points forts et des points faibles de l’IA actuelle.
Le langage, champion de l’IA moderne
Grâce à l’essor des grands modèles de langage (du type GPT), l’IA a fait des bonds spectaculaires en traitement du langage. Les meilleurs modèles comme celui qui fait tourner ChatGPT atteignent globalement le niveau 3 sur l’échelle du langage. Concrètement, ces IA savent lire et rédiger des textes cohérents, traduire, résumer, dialoguer de façon pertinente et dans plusieurs langues. ChatGPT, par exemple, peut expliquer un concept scientifique, rédiger un e-mail professionnel ou même écrire un poème à la demande. C’est un niveau autrefois inimaginable pour une machine.
Cependant, nous ne sommes pas encore au niveau 4 ou 5 sur cette échelle. Les IA actuelles, même brillantes, conservent des lacunes. Elles excellent pour accéder à des connaissances (leur base d’entraînement) et produire du texte bien formé, mais peinent à raisonner finement et à s’adapter en continu. Par exemple, elles peuvent manquer de bon sens dans leurs réponses, ne pas comprendre une blague subtile ou échouer à corriger une erreur à moins d’être ré-entraînées. Leur compréhension reste essentiellement corrélative (statistique) plutôt qu’analytique. En somme, un modèle comme ChatGPT impressionne par la qualité linguistique de ses réponses, mais il lui arrive de “fabuler” des informations ou de ne pas saisir toutes les nuances du contexte – ce qui montre qu’il n’a pas encore la maîtrise totale du langage d’un humain expert. À titre de comparaison, un assistant vocal grand public comme Siri n’atteint qu’un niveau 2 environ : il comprend des consignes simples et y répond, mais montre vite ses limites face à des demandes complexes ou hors de sa base de connaissances.
Vision et créativité : l’IA voit bien, imagine un peu, mais manque de contexte
Dans le domaine de la vision, l’IA a également beaucoup progressé. La reconnaissance d’images par des algorithmes d’apprentissage profond atteint aujourd’hui une précision quasi-humaine pour de nombreuses tâches : identifier des visages ou des objets courants, détecter des anomalies sur une radiographie, piloter partiellement une voiture, etc. Sur l’échelle de la vision de l’OCDE, la majorité des applications actuelles se classent autour du niveau 2 à 3. Cela signifie qu’elles savent très bien analyser des images dans un cadre défini (par exemple reconnaître des objets dans des conditions standardisées). Certaines ont même atteint un niveau 4 sur des tâches spécifiques : on peut citer des systèmes experts capables de comprendre des scènes visuelles complexes mieux que la plupart des humains (par exemple en sécurité/défense, pour repérer des détails indétectables à l’œil nu). Néanmoins, ces cas restent rares : dans un échantillon de 120 applications de vision étudiées par l’OCDE, seules 3 atteignaient le niveau 4, et aucune le niveau 5. La plupart restaient confinées aux niveaux intermédiaires.
Le défi de la vision pour l’IA est de sortir des conditions de laboratoire. Face à des environnements visuels imprévisibles (éclairage changeant, angles de vue inédits, scènes de rue chaotiques), les systèmes actuels montrent vite leurs limites. De même, ils ont du mal à raisonner sur ce qu’ils voient et à s’adapter en temps réel aux changements. Un exemple concret : les voitures autonomes, bourrées de caméras et de capteurs, savent très bien détecter les lignes sur la route ou les autres véhicules (cela, une IA le fait même mieux qu’un humain car elle ne se fatigue pas). Mais qu’un piéton surgisse en courant dans un angle mort, ou que la signalisation soit ambigüe, et le système peut hésiter ou faire une erreur que le conducteur humain aurait su éviter par intuition. Atteindre le niveau 5 en vision nécessitera des IA capables d’apprendre en continu et de généraliser leur perception à n’importe quelle situation visuelle, au lieu de se reposer sur un modèle entraîné une fois pour toutes.
Qu’en est-il de la créativité ? C’est un terrain plus neuf pour l’IA, mais on observe déjà des débuts prometteurs. Les IA génératives comme DALL-E (images) ou ChatGPT (textes) peuvent produire des œuvres visuelles ou écrites originales qui surprennent par leur qualité. Selon l’OCDE, les systèmes actuels atteignent le niveau 1 de créativité (ils créent des contenus « valides » pour un humain) et souvent le niveau 2 (ces créations peuvent être nouvelles et variées). Parfois, ils tutoient même le niveau 3 en générant des résultats surprenants que les humains n’auraient pas forcément imaginés. Un exemple frappant est AlphaZero, le programme de jeu d’échecs et de Go de DeepMind, qui a développé des stratégies gagnantes jugées inédites et déroutantes même pour les champions humains. Dans le domaine artistique, des images créées par IA ont remporté des concours, et des musiques composées par IA imitent de façon crédible le style de compositeurs célèbres.
Cependant, ces IA sont-elles créatives au sens humain ? Pas tout à fait. Elles recombinent de façon sophistiquée ce qu’elles ont appris, mais ne révolutionnent pas les concepts. Les modèles actuels (réseaux neuronaux entraînés sur d’énormes bases de données existantes) ont du mal à produire de véritables inventions qui transforment la pensée humaine ou ouvrent des perspectives totalement inédites. De plus, il leur manque des attributs cruciaux de la créativité humaine : l’intention (avoir un but propre dans la création), l’auto-évaluation (distinguer ce qui est intéressant de ce qui ne l’est pas dans leurs productions) et l’adaptation à un contexte changeant. En somme, si un logiciel peut peindre « à la manière de Van Gogh », il ne sera pas le nouveau Van Gogh qui inventera un mouvement artistique radicalement nouveau. La créativité de l’IA reste pour l’instant assistée par l’humain qui fournit l’impulsion (par exemple en donnant une instruction à DALL-E) et qui souvent fait le tri dans les résultats pour en extraire les meilleures idées.
Raisonner, apprendre et interagir : l’IA reste en apprentissage
Si l’on regarde les autres dimensions cognitives comme le raisonnement ou l’apprentissage, les performances actuelles de l’IA sont mitigées. D’un côté, certaines IA très spécialisées affichent des performances surhumaines dans leur domaine étroit. Par exemple, en résolution de problèmes logiques ou mathématiques bien définis, il existe des algorithmes capables d’explorer des milliers de possibilités en un éclair et de trouver des solutions optimales là où l’esprit humain serait débordé. C’est le cas de solveurs pour des problèmes de planification ou d’optimisation (type planificateurs STRIPS en intelligence artificielle classique, ou solveurs de satisfiabilité pour des problèmes logiques) : ces systèmes, selon l’OCDE, illustrent le niveau 2 de l’échelle de résolution de problèmes, avec même des pointes au-dessus des humains dans des tâches bien encadrées. En revanche, face à des problèmes non structurés du quotidien, qui exigent du bon sens ou une compréhension du contexte social, ces mêmes IA sont perdues.
Les modèles de langage de pointe comme GPT fournissent un autre exemple contrasté. On peut leur soumettre un problème en langage naturel : par exemple « Comment planifier un voyage multi-ville avec des contraintes de budget et d’horaires ? ». Ils vont tenter de le résoudre : cette capacité à interpréter un problème formulé par un humain correspond à un niveau 3 sur l’échelle (ils comprennent l’énoncé, proposent une solution possible). Mais sont-ils vraiment fiables pour autant ? Souvent non : ils manquent de rigueur logique, et leur solution pourra être bancale ou incohérente, révélant qu’en termes de résolution effective de problèmes complexes, ils restent proches du niveau 1 (compétence très limitée). En d’autres termes, ChatGPT peut donner l’illusion de raisonner, mais il n’a pas de moteur de planification solide sous le capot : il s’appuie sur ce qu’il a lu dans ses données d’entraînement et statistiquement, cela peut échouer dès que le problème sort des sentiers battus.
Un domaine où l’on attendrait beaucoup d’une IA est sa capacité d’apprentissage autonome – sa métacognition, c’est-à-dire le fait de réfléchir à sa propre connaissance et de la faire évoluer. Actuellement, les IA apprennent surtout lorsqu’on les entraîne initialement (sur de grandes quantités de données). Mais une fois déployées, elles ont très peu la capacité de s’auto-améliorer en continu par elles-mêmes, contrairement à un humain qui apprend tous les jours de nouvelles choses. Sur l’échelle “connaissance, apprentissage et mémoire”, l’IA moderne se situe globalement au niveau 3. Elle peut emmagasiner énormément d’informations (bien plus qu’un humain), les restituer à la demande et même généraliser en partie à des cas nouveaux grâce aux statistiques. Par exemple, ChatGPT a “en mémoire” une vaste partie d’Internet et peut donc répondre à des questions factuelles assez pointues. Mais cette connaissance reste dépendante des données initiales : l’IA n’ira pas d’elle-même lire le journal du jour pour apprendre les dernières nouvelles, à moins qu’on ne la ré-entraîne explicitement. De même, elle manque de flexibilité : face à une situation totalement nouvelle, un modèle statistique aura du mal à sortir de son cadre. Des travaux commencent à émerger pour doter les IA d’une forme de mémoire autonome (niveau 4) ou pour combiner plusieurs types de mémoire et d’apprentissage dans un système unifié (niveau 5), mais ce sont encore des prototypes de recherche.
Enfin, du côté des interactions sociales, l’IA demeure très limitée. Certes, les chatbots peuvent donner l’illusion d’une conversation amicale et cohérente, et des robots compagnons comme le chien robot AIBO de Sony interagissent avec nous de manière sympathique. Mais aucune machine ne possède aujourd’hui la “flair” sociale innée d’un humain. L’OCDE évalue par exemple que ChatGPT (même avec GPT-4) ne dépasse pas le niveau 2 en interactions sociales . Pourquoi ? Parce que, malgré des prouesses en mémoire (il se rappelle du fil d’une conversation) et en langage, ChatGPT n’a pas de corps ni de véritable identité propre. Il ne perçoit pas réellement les expressions du visage ou le ton émotionnel, et surtout il n’a pas de théorie de l’esprit : il ne devine pas les intentions ou les sentiments de son interlocuteur comme le ferait un humain. De son côté, AIBO est un robot incarné physiquement (il a une présence tangible, il peut se déplacer et réagir à des caresses), ce qui lui donne un petit capital sympathie. Mais son « intelligence sociale » reste rudimentaire : il reconnaît quelques gestes ou mots-clés, sans plus. L’OCDE classe également AIBO au niveau 2 d’interaction sociale – avec des atouts différents de ChatGPT (le corps) mais des manques criants en conversation ou en résolution de problèmes sociaux.
Pour qu’une IA atteigne le niveau 5 en compétences sociales, il lui faudrait intégrer de nombreux aspects : comprendre le langage et le contexte, percevoir les signaux non-verbaux (expressions, postures), se souvenir de l’historique des interactions, s’adapter aux normes sociales implicites, et faire preuve d’empathie et de jugement moral dans des situations complexes. C’est un Everest technologique. L’absence de bon sens et de compréhension réelle des émotions fait que, pour l’instant, l’IA commet des impairs dans des interactions un peu subtiles (blagues ratées, remarques inappropriées). Les chercheurs parlent souvent du problème de la “théorie de l’esprit” : l’IA ne sait pas attribuer aux autres des intentions, des croyances, des désirs – base pourtant de toute interaction humaine réussie. Cela reste un verrou majeur pour des usages avancés comme des assistants pédagogiques virtuels complètement autonomes, ou des robots soignants capables de réelle compassion.
Encadré : Que pourrait faire une IA de niveau intermédiaire en résolution de problèmes ?
Imaginons une IA qui aurait atteint le milieu de l’échelle en résolution de problèmes (niveau ~3) – c’est-à-dire très compétente dans les sciences et la logistique, mais encore limitée en bon sens social et sans incarnation physique avancée. Que pourrait-elle accomplir ? L’OCDE a décrit un scénario où une telle IA aide à gérer une pandémie émergente.
En analysant d’innombrables données (signalements médicaux, posts sur les réseaux sociaux, données météorologiques), l’IA détecte les premiers signes d’une maladie contagieuse transmise par les moustiques. Elle alerte immédiatement les autorités qu’une épidémie se profile et recommande de la déclarer pandémie. Aussitôt, cette IA coordonne des dizaines de laboratoires de recherche pour étudier le nouveau virus : grâce à des robots scientifiques automatisés, elle lance en parallèle des expériences de biologie sur des échantillons provenant du monde entier. Alimentée par toute la littérature médicale existante qu’elle a ingérée, elle formule des hypothèses sur le mode d’action du virus. Certaines pistes sont testées sur des souris ; l’une d’elles révèle une similarité avec une maladie neurologique rare, ce qui oriente l’IA vers un traitement potentiel.
En parallèle, l’IA modélise la propagation de l’épidémie en temps réel et propose des mesures de prévention ciblées (par exemple, distribuer en urgence des moustiquaires dans telle région, lancer telle campagne d’information). Elle aide également à gérer la logistique : elle optimise la distribution des stocks de matériel médical pour qu’aucun hôpital ne manque de respirateurs ou de gants. Finalement, grâce à ses calculs, un vaccin efficace est mis au point en un temps record et la pandémie est jugulée en quelques jours.
Ce scénario de fiction, inspiré de travaux de chercheurs en 2019, montre bien le potentiel d’une IA “presque experte” dans les domaines techniques : détection précoce, analyse de données massives, accélération de la R&D scientifique, optimisation logistique... Toutefois, même à ce niveau, l’IA n’agit pas seule : elle collabore avec des humains (chercheurs, médecins, responsables publics) et elle n’aborde pas les volets sociaux ou éthiques (convaincre la population de se faire vacciner, décider des restrictions de déplacement, etc., restent des décisions humaines). On voit ainsi comment, même très avancée, l’IA resterait un outil assisté par l’humain dans la gestion de crise, prenant en charge les calculs titanesques et laissant aux décideurs la responsabilité des choix de société.
Comment l’IA va transformer le travail dans les PME
Étant donné ce panorama des capacités de l’IA, quelles en seront les conséquences concrètes pour les entreprises, en particulier les PME ? Quels métiers et tâches vont être bouleversés par ces évolutions ? De façon générale, l’IA va surtout automatiser ou assister les tâches pour lesquelles elle a atteint un niveau proche de celui des humains, tandis que les activités où elle reste faible continueront de dépendre principalement de l’humain. Voici quelques domaines d’application et changements à prévoir pour les PME.

Automatisation des tâches routinières et du traitement d’information
C’est probablement le premier impact. Les IA de niveau 3 en langage et en vision excellent à analyser de grandes quantités d’informations et à produire des documents structurés. Dans une PME, cela signifie par exemple automatiser la saisie de données (reconnaissance automatique de factures ou de formulaires), le classement de documents ou d’e-mails, voire la réponse aux questions fréquentes des clients via un chatbot. Un service client équipé d’une IA conversationnelle peut traiter 24h/24 les demandes basiques (suivi de colis, renseignements simples) en langage naturel. De même, un logiciel d’IA peut analyser des centaines de CV reçus pour un poste et pré-sélectionner ceux qui correspondent aux critères, ou bien surveiller les réseaux sociaux pour extraire les retours clients pertinents. Toutes ces tâches à base de recherche, de tri, de synthèse d’information – auparavant très chronophages – peuvent être grandement accélérées par l’IA, libérant du temps humain pour d’autres missions.

Nouvelles capacités d’analyse et aide à la décision
L’IA apporte aux PME des outils d’analyse avancée autrefois réservés aux grands groupes disposant de data scientists. Par exemple, une IA de niveau 3-4 en résolution de problèmes, couplée à de grandes bases de données, peut aider à détecter des tendances de marché ou à faire des prévisions. Une petite entreprise de vente en ligne peut utiliser des algorithmes prédictifs pour estimer la demande de tel produit le mois prochain et ajuster son stock en conséquence. De même, des IA d’analyse visuelle peuvent contrôler automatiquement la qualité de produits sur une ligne de production (détecter des défauts sur des pièces via caméra), ce qui réduit le risque d’erreurs humaines et améliore le contrôle qualité. En marketing, des outils d’IA analysent le comportement des clients (clics, achats) et suggèrent des actions ciblées pour chaque segment de clientèle. On parle de systèmes d’aide à la décision : l’IA ne prend pas la décision finale à la place du dirigeant, mais lui fournit des insights clairs et rapides qu’il n’aurait pas pu obtenir manuellement sans des semaines d’analyse.

Évolution des compétences requises chez les employés :
Si certaines tâches sont automatisées, le travail humain se reconcentre sur ce que l’IA ne sait pas bien faire. On verra donc d’autant plus la valeur des compétences humaines difficiles à automatiser : la créativité conceptuelle, le sens relationnel, la négociation, l’intelligence émotionnelle, ou tout simplement la polyvalence et l’adaptation à des situations inédites. Par exemple, un comptable dans une PME utilisera un logiciel d’IA pour classer automatiquement les factures et préparer les grands livres ; son rôle évoluera vers plus de contrôle, d’analyse fine des chiffres et de conseil stratégique au dirigeant (ce qu’une IA ne peut pas assumer, car cela requiert du jugement business et de la communication). De même, l’équipe support client d’une PME verra ses effectifs se concentrer sur les cas complexes ou délicats nécessitant de la personnalisation et de l’empathie, tandis que le chatbot gèrera la routine. Il faudra donc former les salariés à travailler avec l’IA : apprendre à exploiter les recommandations d’un algorithme, à détecter ses éventuelles erreurs, et à développer les complémentarités. Dans de nombreux secteurs, l’augmentation de l’humain par l’IA (plutôt que son remplacement pur et simple) sera le modèle gagnant : un collaborateur muni d’un bon outil d’IA sera plus productif et pertinent, un peu comme un ouvrier avec une machine-outil performante.
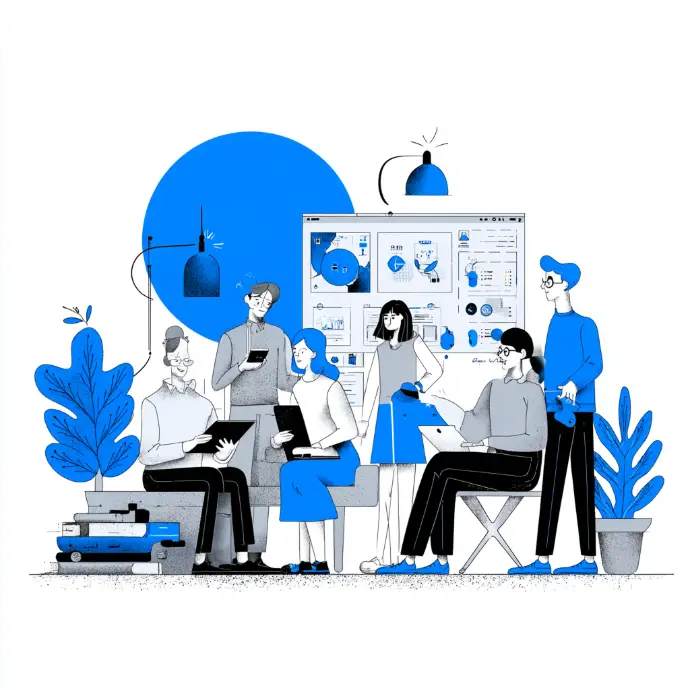
Opportunités de nouvelles offres et services
L’IA ouvre aussi la porte à des innovations dans les PME. Par exemple, grâce aux modèles génératifs, une petite agence de design peut proposer à ses clients de multiples ébauches graphiques créées par IA pour affiner plus rapidement un concept. Une start-up peut bâtir un service en ligne automatisé qu’elle n’aurait pas pu développer auparavant (par ex., une plateforme qui génère automatiquement du contenu personnalisé pour chaque utilisateur, ou un coach virtuel en ligne dans le domaine de la santé, etc.). L’IA peut aussi permettre d’adapter des produits à chaque client à grande échelle : dans la mode, certaines PME utilisent l’IA pour conseiller des tenues personnalisées selon les goûts exprimés par le client ; dans l’éducation, de jeunes entreprises proposent des parcours d’apprentissage ajustés en temps réel au niveau de l’élève grâce à des algorithmes. En résumé, au-delà de l’optimisation interne, l’IA peut devenir un facteur d’innovation et de différenciation pour les PME agiles qui sauront l’intégrer dans leur modèle d’affaires.
Évidemment, ces transformations ne vont pas sans défis. Le personnel doit être formé, l’IA a un coût (même si de nombreuses solutions deviennent abordables en ligne), et il faut aussi gérer les risques : par exemple, vérifier que l’IA ne soit pas biaisée ou qu’elle ne fasse pas d’erreurs graves sans qu’on s’en rende compte. Mais ignorer l’IA serait sans doute plus risqué encore, car les concurrents, eux, pourraient prendre une longueur d’avance en l’adoptant. La clé est donc d’y aller progressivement et intelligemment, en identifiant où elle apporte le plus de valeur ajoutée.
Dirigeants de PME : à quoi faut-il être attentif ?
Face à l’IA, un dirigeant de PME a tout intérêt à adopter une approche proactive et réfléchie. Voici quelques conseils pratiques pour anticiper les changements à venir et en tirer le meilleur parti :
- Suivre de près les avancées de l’IA dans votre secteur. Quelles nouvelles solutions d’IA émergent dans votre domaine d’activité ? Qu’utilisent vos concurrents ? Restez en veille. Les capacités de l’IA évoluent vite : ce qui était hors de portée il y a trois ans (par exemple la traduction automatique fiable) est devenu banal aujourd’hui. Les indicateurs de l’OCDE, mis à jour régulièrement, peuvent servir de baromètre général. Identifiez surtout les avancées pertinentes pour vos métiers : par exemple, vision industrielle pour une PME manufacturière, analyse de textes pour une entreprise juridique, etc.
- Cartographiez les tâches de votre entreprise selon les capacités de l’IA. Listez les principales tâches effectuées par vos employés ou vous-même, et demandez-vous pour chacune : quelles aptitudes cela requiert-il ? Du traitement de langage ? De la dextérité manuelle ? De la créativité ? Et à quel niveau de finesse ? Ensuite, confrontez cela à l’état de l’art de l’IA. L’exercice proposé par l’OCDE consiste à évaluer le niveau requis par chaque tâche et à voir si l’IA a atteint ou non ce niveau. Par exemple, si une tâche demande un haut niveau d’interactions sociales (ex. négocier un contrat complexe), et que l’IA n’est qu’au niveau 2 dans ce domaine, vous savez que cette tâche restera humaine. En revanche, si une tâche demande de la reconnaissance visuelle de niveau 3 (ex. contrôler l’aspect d’un produit standard) et que l’IA en vision est déjà à 3 solide, envisagez de déléguer cette tâche à l’IA à terme. Cet exercice vous donne une vision claire des automatismes possibles et des collaborations humain-IA à organiser.
- Posez-vous les bonnes questions avant d’automatiser. Ce n’est pas parce qu’une IA peut faire quelque chose qu’il faut forcément lui confier la tâche. Demandez-vous d’abord : “Est-ce souhaitable ?”. Par exemple, vos clients accepteront-ils de parler à un chatbot plutôt qu’à un humain pour le support ? Y a-t-il un risque pour la qualité ou l’image de votre entreprise ? Ensuite : “Est-ce que la technologie est suffisamment mûre ?”. Il existe peut-être des IA incroyables en laboratoire, mais un outil clé en main sur le marché est-il disponible et fiable ? Rien ne sert d’être trop pionnier si le coût est prohibitif ou les bugs fréquents. Enfin : “Comment organiser le travail si j’adopte cette IA ?”. Faut-il former quelqu’un pour superviser la machine ? Quelles nouvelles compétences seront nécessaires en interne ? Qui fera la maintenance, et quel plan B si l’IA tombe en panne ou se trompe ? En résumé, automatisez avec discernement, dans une optique d’amélioration globale, pas juste pour la nouveauté.
- Investissez dans les compétences humaines complémentaires. Comme souligné plus haut, plus l’IA prendra en charge la partie « mécanique » ou analytique des tâches, plus la valeur des salariés résidera dans ce que la machine ne sait pas faire. Identifiez les compétences clés à renforcer chez vos collaborateurs : par exemple, l’esprit critique (pour valider ou non les suggestions de l’IA), la créativité, l’aisance relationnelle, la capacité à interpréter les données avec du contexte métier, etc. Envisagez des formations pour acculturer tout le monde à l’IA, ne serait-ce que sur comment fonctionne un outil d’IA et quelles sont ses limites. Cela évitera à la fois la méfiance irrationnelle et l’excès de confiance. Un employé formé saura utiliser l’IA comme un allié et non la percevoir comme une menace.
- Anticipez l’évolution à moyen terme. Enfin, gardez en tête que l’IA d’aujourd’hui n’est pas figée. Les indicateurs de l’OCDE sont en version bêta et vont s’affiner, mais ils ont vocation à être mis à jour à mesure que l’IA progresse. Peut-être que dans 5 ans, l’IA atteindra le niveau 4 en langage et le niveau 3 en social, par exemple. Cela pourrait élargir le champ des tâches automatisables (y compris dans des fonctions de management intermédiaire, de la formation, etc.). Projetez-vous dans ces scénarios. L’OCDE suggère de construire, avec les acteurs du secteur, des scénarios métier décrivant comment un travail pourrait évoluer si l’IA gagne un ou deux niveaux de plus. Exercez-vous à cet horizon : si demain les assistants vocaux comprennent tout et répondent avec un ton vraiment naturel, comment cela changerait-il la relation client chez vous ? Si des robots mobiles de niveau 3 apparaissent (capables d’évoluer en environnement semi-ouvert), que feriez-vous de cette technologie dans votre entrepôt ou votre atelier ? Cet effort d’anticipation vous permettra de ne pas être pris de court et d’y penser sereinement en amont plutôt que dans l’urgence.
En conclusion : mesurer pour mieux agir
En vulgarisant le contenu du rapport « Présentation des indicateurs de l’OCDE sur les capacités de l’IA », ce dossier a voulu donner aux non-spécialistes – en particulier aux dirigeants de PME – des repères concrets sur ce dont l’IA est capable aujourd’hui, et ce vers quoi elle tend. Retenons que l’IA n’a pas (encore) toutes les capacités de l’humain : elle maîtrise de mieux en mieux le langage, l’analyse d’images, l’apprentissage de faits ou la génération de contenus, mais reste déficiente en bon sens, en interaction humaine riche, en adaptabilité totale et en créativité radicale. Grâce aux neuf indicateurs de l’OCDE, on peut suivre ces évolutions de manière structurée, presque comme on suivrait la courbe de croissance d’un enfant sur un carnet de santé – sauf qu’ici l’« enfant » est technologique.
Pour les PME, l’enjeu n’est pas de spéculer abstraitement sur une « IA qui va tout remplacer », mais d’évaluer tâche par tâche comment tirer parti de l’IA là où elle est forte, et comment s’appuyer sur l’humain là où elle est faible. En ce sens, mesurer les capacités de l’IA permet de prendre des décisions éclairées : quelles opérations automatiser, comment redéployer les talents, où investir, etc. Comme tout outil puissant, l’IA comporte des risques, mais bien employée elle peut décupler l’efficacité et ouvrir de nouvelles possibilités, même pour une petite entreprise.
La dernière recommandation serait donc : gardez un esprit critique mais ouvert. Informez-vous (les travaux de l’OCDE sont là pour ça), testez à petite échelle dans votre organisation, et n’hésitez pas à échanger avec vos pairs sur leurs retours d’expérience. L’IA évolue vite, mais en surveillant ses « indicateurs de croissance », vous aurez les cartes en main pour anticiper plutôt que subir ses effets sur votre activité. En somme, connaître les capacités réelles de l’IA aujourd’hui, c’est se donner la capacité, soi, de mieux piloter son entreprise demain.
Source : OCDE (2025), Présentation des indicateurs de l’OCDE sur les capacités de l’IA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/d321ba78-fr.