Nous entendons de plus en plus parler de la taxonomie verte européenne, sans toujours savoir ce qui se cache derrière ce terme. Il s’agit en réalité d’un règlement européen de 2020 qui définit un langage commun pour identifier quelles activités économiques sont considérées comme durables sur le plan environnemental. Son objectif est clair : réorienter les investissements vers des activités favorables à la transition écologique (comme la lutte contre le changement climatique) et éviter le greenwashing en établissant des critères objectifs. Concrètement, la taxonomie permet de mesurer la part “verte” des activités d’une entreprise ou d’un fonds d’investissement et sert déjà de référence pour attribuer des labels “verts” (par exemple, le futur standard européen des obligations vertes). Voyons ensemble en quoi consiste cette taxonomie, à qui elle s’applique et pourquoi nous, petites et moyennes entreprises (PME), devons nous y intéresser dès maintenant.
Qu’est-ce que la taxonomie verte de l’UE ?
La taxonomie verte de l’Union européenne est un système de classification des activités économiques durables, instauré dans le cadre du Pacte vert européen. Elle définit six grands objectifs environnementaux auxquels une activité peut contribuer :
atténuation du changement climatique ;
adaptation au changement climatique ;
utilisation durable et protection des ressources en eau et des ressources marines ;
transition vers une économie circulaire ;
contrôle et prévention de la pollution ;
protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Pour qu’une activité soit officiellement considérée comme « durable » dans cette taxonomie, elle doit remplir trois conditions cumulatives : contribuer de manière substantielle à au moins un des six objectifs ci-dessus ; ne pas causer de préjudice significatif aux cinq autres objectifs (principe du “Do No Significant Harm”) ; et respecter des garanties sociales minimales (droits humains, normes du travail, etc.). En pratique, des critères techniques précis (seuils d’émissions, normes à respecter…) sont définis pour chaque secteur afin d’évaluer objectivement si une activité « fait assez » pour être qualifiée de durable. Grâce à ces principes, la taxonomie verte offre un référentiel commun qui favorise la transparence des marchés financiers et oblige chacun à prouver ses engagements environnementaux sur des bases mesurables plutôt que de simples déclarations d’intention.
À quelles entreprises s’applique-t-elle directement ?
Initialement, la taxonomie verte cible avant tout les grandes entreprises et les institutions financières. En effet, ce sont les entreprises déjà soumises au reporting extra-financier (désormais la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) qui doivent en premier communiquer sur la classification de leurs activités. Ces grandes entreprises – typiquement celles de plus de 500 salariés relevant de la Déclaration de performance extra-financière (DPEF) – ont l’obligation depuis 2022-2023 d’indiquer quelle part de leur chiffre d’affaires, de leurs investissements (CapEx) et de leurs dépenses opérationnelles (OpEx) correspond à des activités durables au sens de la taxonomie verte. Autrement dit, un grand groupe doit publier la proportion “verte” de ses activités, calculée selon les critères de l’UE.
Cette obligation réglementaire va s’étendre progressivement à davantage d’entreprises dans les prochaines années. À partir de l’exercice 2025, toutes les entreprises dépassant deux des trois critères (250 employés, 40 M€ de chiffre d’affaires, 20 M€ de bilan) seront couvertes par la CSRD et donc concernées par la taxonomie. Cela inclut bon nombre d’entreprises de taille intermédiaire. Et à partir de l’exercice 2026, ce sera au tour des PME cotées en bourse de publier des informations sur la durabilité de leurs activités (avec toutefois des exigences allégées pour ces PME et un calendrier d’adoption progressive). On estime qu’au total environ 50 000 entreprises en Europe seront assujetties à ces obligations de transparence climatique et environnementale. Notons que des discussions sont en cours pour simplifier certaines règles pour les plus petites entités, mais la trajectoire générale reste la même : de plus en plus d’acteurs économiques doivent rendre des comptes sur leur « part verte » dans l’économie.
En plus des entreprises “corporate”, le secteur financier est pleinement concerné. Les banques, gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance et autres investisseurs institutionnels doivent eux aussi évaluer et divulguer la part d’investissements verts dans leurs portefeuilles. Par exemple, une banque doit informer ses clients du degré d’alignement de ses fonds ou produits financiers sur la taxonomie verte. L’objectif est d’orienter le capital vers des activités durables : ainsi, les investissements dans des entreprises alignées sur la taxonomie seront mis en avant (et parfois favorisés via des labels ou des taux bonifiés), tandis que les financements d’activités non durables deviendront plus coûteux ou plus difficiles à justifier.
Pourquoi même les PME non assujetties doivent s’y intéresser ?
À première vue, une petite entreprise n’ayant pas l’obligation légale de publier un rapport de durabilité pourrait penser que la taxonomie verte ne la concerne pas. En réalité, nous ferions bien de nous y intéresser dès maintenant, car l’écosystème économique tout entier est en train d’intégrer ces critères. Même sans contrainte réglementaire directe, plusieurs facteurs exercent dès aujourd’hui une pression indirecte sur les PME pour qu’elles adoptent une démarche plus « verte » :

Pression des clients (donneurs d’ordres)
Nos clients les plus importants – en particulier les grands groupes soumis, eux, à la taxonomie – vont exiger de nous des comptes. Les grandes entreprises assujetties doivent en effet faire respecter certains critères de durabilité tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Concrètement, si nous sommes fournisseur d’un grand groupe, celui-ci pourra nous demander de prouver que nos produits ou services respectent des standards environnementaux (faible empreinte carbone, éco-conception, etc.) afin qu’il puisse, de son côté, déclarer une supply chain alignée avec la taxonomie. Les PME sous-traitantes ressentent donc déjà la pression de leurs clients : ne pas pouvoir fournir de données ESG fiables ou ne pas faire d’efforts de durabilité pourrait nous faire perdre des contrats au profit de concurrents plus vertueux.

Exigences des investisseurs et des financeurs
Les banques et les investisseurs intègrent de plus en plus les critères de la taxonomie dans leurs décisions. Étant elles-mêmes tenues de verdir leurs portefeuilles, les institutions financières favorisent les projets alignés sur la taxonomie. À l’inverse, elles commencent à appliquer des “primes de risque” aux activités non durables, ce qui peut se traduire pour nous par des taux d’intérêt plus élevés sur un prêt si notre projet n’est pas jugé assez vert, voire par des difficultés à financer certaines opérations polluantes. Par exemple, une PME industrielle qui sollicite un emprunt pour moderniser son outil de production aura tout intérêt à mettre en avant les aspects écologiques de son projet (gain d’efficacité énergétique, réduction des émissions…) – faute de quoi la banque pourrait hésiter ou proposer des conditions moins avantageuses. De même, des investisseurs (fonds, business angels) privilégient désormais les entreprises ayant une stratégie durable, et écartent celles qui ne s’alignent pas sur les nouvelles normes climatiques.

Appels d’offres et marchés publics/privés
Les critères RSE (responsabilité sociétale et environnementale) sont de plus en plus intégrés dans les appels d’offres. De plus en plus de donneurs d’ordre, qu’ils soient publics ou grandes entreprises privées, exigent des preuves concrètes d’engagement environnemental de la part de leurs fournisseurs avant de attribuer un marché. Cela signifie que, pour remporter un appel d’offres, nous devons être en mesure de répondre à des questionnaires ou à des grilles d’évaluation ESG (par exemple : avons-nous une politique de réduction des déchets ? suivons-nous nos émissions de CO₂ ? utilisons-nous des matières recyclées ?). Un fabricant ou un prestataire de services incapable de démontrer un minimum d’actions en faveur de la transition écologique part avec un handicap sérieux dans la compétition. À l’inverse, afficher de bonnes pratiques environnementales constitue désormais un avantage concurrentiel décisif pour convaincre les clients les plus exigeants.
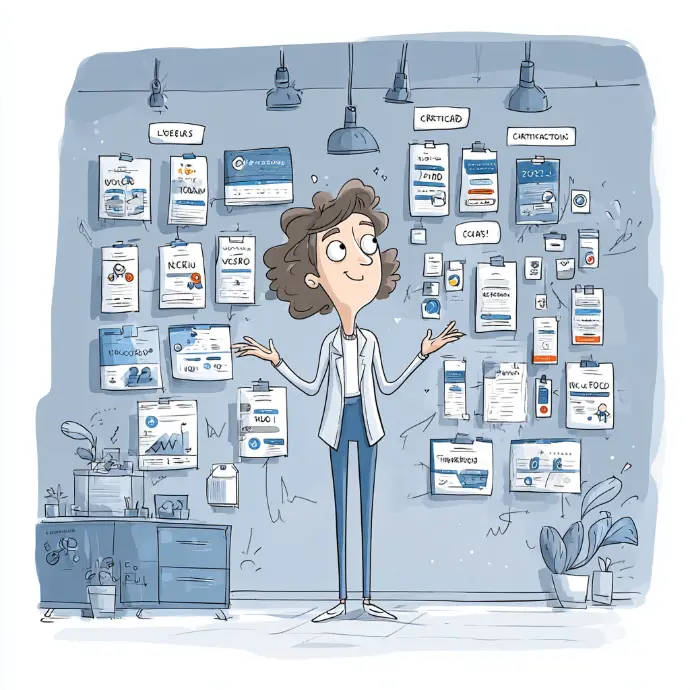
Labels RSE, image et réputation
Même en l’absence de contrainte extérieure, beaucoup de PME choisissent volontairement de s’aligner sur les objectifs de la taxonomie ou d’améliorer leur profil ESG, car c’est un gage de sérieux et de confiance pour l’ensemble des parties prenantes. S’engager dans une démarche durable dès aujourd’hui permet de valoriser notre image de marque et de rassurer nos clients, partenaires et collaborateurs sur notre avenir. Par exemple, obtenir un label RSE ou une certification (comme le label Lucie, ISO 14001, ou même B-Corp) peut prouver concrètement notre engagement et nous démarquer positivement. C’est aussi un investissement “réputationnel” : nous montrons que nous faisons partie des acteurs responsables, ce qui peut attirer de nouveaux clients sensibles à ces enjeux, faciliter des partenariats ou même améliorer notre marque employeur. En somme, intégrer progressivement les principes de la taxonomie dans notre stratégie est une façon de « se mettre dans le bon wagon » de la transition verte, avant d’y être contraints et forcés.
Quels impacts concrets pour un fournisseur PME ?
Pour illustrer plus concrètement, plaçons-nous dans la peau d’un fournisseur de petite taille travaillant pour de grandes entreprises. Les effets de la taxonomie verte peuvent déjà se faire sentir dans notre activité quotidienne.
Imaginons, par exemple, que nous dirigions une PME industrielle fournissant des pièces à un grand constructeur automobile. Ce client nous impose désormais de mesurer et réduire nos émissions de CO₂ liées à la fabrication de ces pièces. Pourquoi ? Parce que les émissions de notre PME entrent dans le bilan carbone global de ce constructeur (ce qu’on appelle les émissions indirectes ou Scope 3 amont). S’il veut améliorer son propre score de durabilité et augmenter la part verte de ses activités, il doit s’assurer que ses fournisseurs suivent la même voie. Concrètement, il peut nous demander de fournir des données sur la consommation d’énergie de notre usine, sur la part de matériaux recyclés dans nos produits, ou encore sur nos initiatives pour réduire les déchets. Il peut même exiger, via des clauses contractuelles, que nous atteignions certains objectifs (par exemple, alimenter notre site en électricité 100 % renouvelable d’ici deux ans, ou réduire de 30 % l’empreinte carbone d’une pièce d’ici 2030). Si nous ne jouons pas le jeu, le client pourra décider de chercher un autre fournisseur plus en ligne avec sa stratégie climat. À l’inverse, si nous prenons les devants et collaborons avec lui (par exemple en co-développant des pièces plus éco-conçues), nous renforçons la relation commerciale et nous nous inscrivons dans la durée avec ce donneur d’ordre.
Le secteur des services est également concerné par ces évolutions. Prenons le cas d’une PME de services, par exemple une entreprise de nettoyage industriel ou de logistique. De plus en plus souvent, dans les cahiers des charges, nos clients incluent des critères environnementaux et sociaux : utilisation de produits d’entretien écologiques, flotte de véhicules à faibles émissions, conditions de travail responsables, etc. Si nous souhaitons gagner un contrat de nettoyage sur un site tertiaire ou un contrat de transport pour une grande enseigne, nous devrons démontrer nos bonnes pratiques (fournir la liste des produits écolabellisés que nous utilisons, prouver que nos chauffeurs sont formés à l’éco-conduite, présenter un plan pour renouveler nos véhicules diesel par des modèles électriques, etc.). Là encore, les PME qui auront anticipé ces demandes partiront avec une longueur d’avance. Celles qui, en revanche, n’auront aucune donnée ni politique RSE à présenter risquent de perdre des opportunités d’affaires. En somme, que l’on soit fournisseur industriel ou prestataire de services, la durabilité est en passe de devenir un critère de sélection majeur dans nos relations B2B. Nous avons donc tout intérêt à nous préparer à ces attentes pour conserver et conquérir des marchés.
Comment commencer à se préparer dès maintenant ?
Face à ces tendances lourdes, nous, PME, pouvons dès aujourd’hui prendre quelques mesures simples pour nous adapter progressivement. Inutile d’être des experts de la finance durable du jour au lendemain : l’important est de faire le premier pas et d’inscrire notre entreprise dans une démarche d’amélioration continue. Voici quelques pistes concrètes pour démarrer :

Jouer la transparence avec nos partenaires : N’attendons pas qu’un client ou qu’un investisseur nous arrache les informations. Dès à présent, nous pouvons communiquer ouvertement sur nos pratiques et nos engagements environnementaux, même s’ils sont modestes. Par exemple, indiquer sur notre site web ou dans nos offres commerciales les actions déjà en place (tri des déchets, approvisionnement local, économies d’énergie…) montre que nous sommes sensibilisés. Si nos performances ne sont pas encore excellentes, nous pouvons le reconnaître honnêtement et expliquer nos plans d’amélioration. Cette transparence sera généralement appréciée : mieux vaut annoncer franchement où nous en sommes et ce que nous comptons faire, plutôt que de rester silencieux (au risque de paraître inactifs) ou d’exagérer nos accomplissements (au risque de perdre la confiance plus tard). En interne, cette culture de transparence implique aussi de sensibiliser nos équipes aux enjeux RSE, afin que chacun soit conscient de l’importance de ces sujets pour l’entreprise.
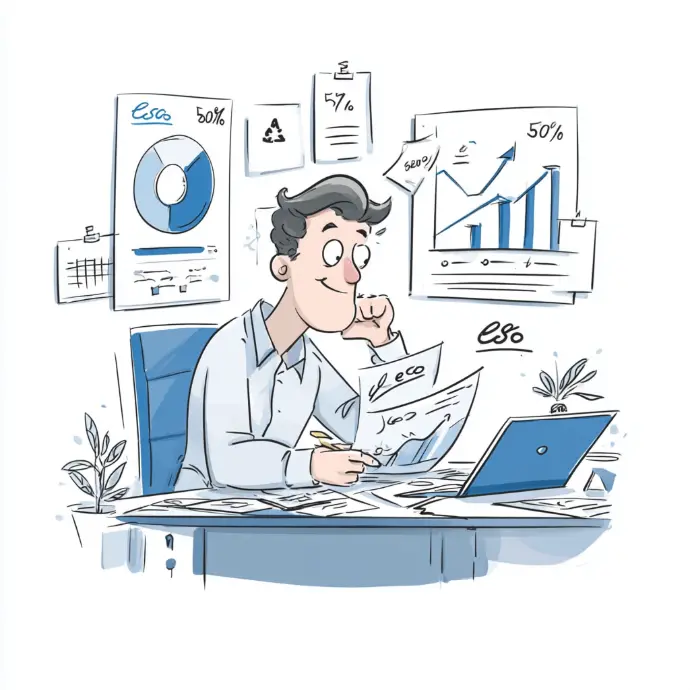
Collecter quelques données ESG de base : Il est difficile d’améliorer ce qu’on ne mesure pas. Une bonne première étape consiste donc à réunir les données environnementales et sociales de base concernant notre activité. Sans tomber dans la lourdeur administrative, nous pouvons commencer par prendre la mesure de notre empreinte carbone directe (par exemple, nos consommations annuelles d’énergie, de carburant, notre volume de déchets, etc.). Des outils simples ou des calculateurs en ligne existent pour aider les PME à estimer leurs émissions de CO₂ (bilan carbone simplifié). De même, rassembler des indicateurs sociaux simples – nombre de salariés, répartition hommes-femmes, heures de formation, etc. – fait partie des bonnes pratiques ESG. Ces données de base nous serviront à la fois en interne (pour identifier où agir en priorité) et en externe : le jour où un client ou une banque nous questionnera, nous aurons déjà quelques éléments chiffrés fiables à fournir, plutôt que de répondre “on ne sait pas”. Par exemple, être capable de dire « Nous avons consommé X kWh d’électricité en 2024 dont 50 % d’origine renouvelable, et nous visons 75 % en 2025 » ou « Nous avons réduit de Y % nos déchets l’an dernier » peut faire la différence. L’idée n’est pas d’atteindre tout de suite des performances de grand groupe, mais d’avoir des ordres de grandeur et de montrer une trajectoire.

Identifier les opportunités d’alignement “vert” : Nous devrions nous pencher sur nos produits et services pour voir si certains peuvent être rapprochés des objectifs de la taxonomie verte – et comment. Autrement dit, dans quelle mesure notre activité contribue-t-elle positivement à l’un des six grands objectifs environnementaux, et pouvons-nous accentuer cette contribution ? Par exemple, si nous sommes dans le secteur du bâtiment (construction ou rénovation), la taxonomie prévoit des critères précis (comme un certain niveau de performance énergétique ou la réalisation d’une analyse de cycle de vie pour les bâtiments de plus de 5000 m²) pour classer une activité comme durable. Sans nécessairement viser tout de suite la conformité totale à ces critères techniques, nous pouvons essayer d’aligner progressivement nos pratiques : utiliser des matériaux plus durables, améliorer l’efficacité énergétique de nos processus, développer une offre de produits “verts” si possible. Une entreprise de transport routier, par exemple, peut investir dans quelques véhicules électriques ou au bioGNV pour amorcer une flotte propre. Un fabricant peut évaluer s’il lui est possible d’utiliser une part de matières recyclées ou d’obtenir une certification environnementale sur un produit. En faisant cet exercice, nous pourrons peut-être mettre en avant une part de notre chiffre d’affaires “verte” – même modeste – auprès de nos partenaires. Il s’agit de montrer que certaines de nos activités contribuent concrètement à la transition écologique, ce qui sera de plus en plus valorisé. En parallèle, soyons vigilants à “ne pas nuire” : vérifier que nos autres activités minimisent leurs impacts négatifs (pas de pollution majeure non traitée, pas de destruction d’écosystèmes, etc.), conformément à l’esprit du principe DNSH de la taxonomie.

Se faire accompagner et valoriser nos efforts : La bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes pas seuls. De nombreuses ressources d’accompagnement existent pour aider les PME dans cette transition. Par exemple, les Chambres de Commerce et d’Industrie proposent souvent des diagnostics RSE ou des « starter kits » développement durable. Des programmes publics peuvent subventionner un premier bilan carbone ou des investissements verts (équipements moins énergivores, panneaux solaires sur le toit, etc.). S’entourer de conseils ou s’inspirer de l’expérience d’autres PME peut nous faire gagner du temps. Par ailleurs, nous pouvons envisager d’obtenir un label ou une certification qui atteste de notre engagement. Cela donne un cadre structurant et crédibilise nos actions. Certaines PME ont déjà franchi le pas : Bamolux, une petite entreprise d’aménagement intérieur au Luxembourg, a par exemple obtenu le label ESR (Entreprise socialement responsable) et s’est engagée dans une certification B-Corp, afin de cadrer ses initiatives de développement durable et de les faire reconnaître. Sans forcément viser une certification internationale d’emblée, nous pourrions commencer par une évaluation RSE adaptée à notre taille (il existe des plateformes de notation dédiées aux PME, ou la nouvelle norme volontaire VSME – Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs – qui fournit un canevas allégé pour structurer son reporting durable). L’important est de valoriser nos progrès : une fois que nous avons mis en place des actions (même simples, comme installer des éclairages LED, former nos employés aux éco-gestes, ou établir un code éthique fournisseur), il faut le faire savoir à nos clients et partenaires. Présenter une carte d’identité RSE de notre entreprise, actualisée chaque année, peut par exemple être une bonne pratique. Cela montrera que nous prenons le sujet au sérieux et que nous avançons dans la bonne direction, ce qui sera apprécié et potentiellement exigé demain.
Comment commencer à se préparer dès maintenant ?
Face à ces tendances lourdes, nous, PME, pouvons dès aujourd’hui prendre quelques mesures simples pour nous adapter progressivement. Inutile d’être des experts de la finance durable du jour au lendemain : l’important est de faire le premier pas et d’inscrire notre entreprise dans une démarche d’amélioration continue. Voici quelques pistes concrètes pour démarrer :

Jouer la transparence avec nos partenaires : N’attendons pas qu’un client ou qu’un investisseur nous arrache les informations. Dès à présent, nous pouvons communiquer ouvertement sur nos pratiques et nos engagements environnementaux, même s’ils sont modestes. Par exemple, indiquer sur notre site web ou dans nos offres commerciales les actions déjà en place (tri des déchets, approvisionnement local, économies d’énergie…) montre que nous sommes sensibilisés. Si nos performances ne sont pas encore excellentes, nous pouvons le reconnaître honnêtement et expliquer nos plans d’amélioration. Cette transparence sera généralement appréciée : mieux vaut annoncer franchement où nous en sommes et ce que nous comptons faire, plutôt que de rester silencieux (au risque de paraître inactifs) ou d’exagérer nos accomplissements (au risque de perdre la confiance plus tard). En interne, cette culture de transparence implique aussi de sensibiliser nos équipes aux enjeux RSE, afin que chacun soit conscient de l’importance de ces sujets pour l’entreprise.
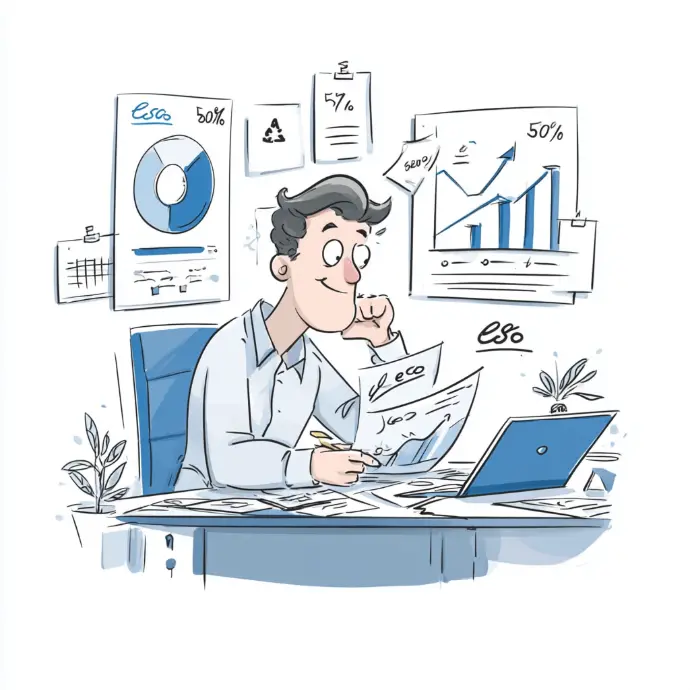
Collecter quelques données ESG de base : Il est difficile d’améliorer ce qu’on ne mesure pas. Une bonne première étape consiste donc à réunir les données environnementales et sociales de base concernant notre activité. Sans tomber dans la lourdeur administrative, nous pouvons commencer par prendre la mesure de notre empreinte carbone directe (par exemple, nos consommations annuelles d’énergie, de carburant, notre volume de déchets, etc.). Des outils simples ou des calculateurs en ligne existent pour aider les PME à estimer leurs émissions de CO₂ (bilan carbone simplifié). De même, rassembler des indicateurs sociaux simples – nombre de salariés, répartition hommes-femmes, heures de formation, etc. – fait partie des bonnes pratiques ESG. Ces données de base nous serviront à la fois en interne (pour identifier où agir en priorité) et en externe : le jour où un client ou une banque nous questionnera, nous aurons déjà quelques éléments chiffrés fiables à fournir, plutôt que de répondre “on ne sait pas”. Par exemple, être capable de dire « Nous avons consommé X kWh d’électricité en 2024 dont 50 % d’origine renouvelable, et nous visons 75 % en 2025 » ou « Nous avons réduit de Y % nos déchets l’an dernier » peut faire la différence. L’idée n’est pas d’atteindre tout de suite des performances de grand groupe, mais d’avoir des ordres de grandeur et de montrer une trajectoire.

Identifier les opportunités d’alignement “vert” : Nous devrions nous pencher sur nos produits et services pour voir si certains peuvent être rapprochés des objectifs de la taxonomie verte – et comment. Autrement dit, dans quelle mesure notre activité contribue-t-elle positivement à l’un des six grands objectifs environnementaux, et pouvons-nous accentuer cette contribution ? Par exemple, si nous sommes dans le secteur du bâtiment (construction ou rénovation), la taxonomie prévoit des critères précis (comme un certain niveau de performance énergétique ou la réalisation d’une analyse de cycle de vie pour les bâtiments de plus de 5000 m²) pour classer une activité comme durable. Sans nécessairement viser tout de suite la conformité totale à ces critères techniques, nous pouvons essayer d’aligner progressivement nos pratiques : utiliser des matériaux plus durables, améliorer l’efficacité énergétique de nos processus, développer une offre de produits “verts” si possible. Une entreprise de transport routier, par exemple, peut investir dans quelques véhicules électriques ou au bioGNV pour amorcer une flotte propre. Un fabricant peut évaluer s’il lui est possible d’utiliser une part de matières recyclées ou d’obtenir une certification environnementale sur un produit. En faisant cet exercice, nous pourrons peut-être mettre en avant une part de notre chiffre d’affaires “verte” – même modeste – auprès de nos partenaires. Il s’agit de montrer que certaines de nos activités contribuent concrètement à la transition écologique, ce qui sera de plus en plus valorisé. En parallèle, soyons vigilants à “ne pas nuire” : vérifier que nos autres activités minimisent leurs impacts négatifs (pas de pollution majeure non traitée, pas de destruction d’écosystèmes, etc.), conformément à l’esprit du principe DNSH de la taxonomie.

Se faire accompagner et valoriser nos efforts : La bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes pas seuls. De nombreuses ressources d’accompagnement existent pour aider les PME dans cette transition. Par exemple, les Chambres de Commerce et d’Industrie proposent souvent des diagnostics RSE ou des « starter kits » développement durable. Des programmes publics peuvent subventionner un premier bilan carbone ou des investissements verts (équipements moins énergivores, panneaux solaires sur le toit, etc.). S’entourer de conseils ou s’inspirer de l’expérience d’autres PME peut nous faire gagner du temps. Par ailleurs, nous pouvons envisager d’obtenir un label ou une certification qui atteste de notre engagement. Cela donne un cadre structurant et crédibilise nos actions. Certaines PME ont déjà franchi le pas : Bamolux, une petite entreprise d’aménagement intérieur au Luxembourg, a par exemple obtenu le label ESR (Entreprise socialement responsable) et s’est engagée dans une certification B-Corp, afin de cadrer ses initiatives de développement durable et de les faire reconnaître. Sans forcément viser une certification internationale d’emblée, nous pourrions commencer par une évaluation RSE adaptée à notre taille (il existe des plateformes de notation dédiées aux PME, ou la nouvelle norme volontaire VSME – Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs – qui fournit un canevas allégé pour structurer son reporting durable). L’important est de valoriser nos progrès : une fois que nous avons mis en place des actions (même simples, comme installer des éclairages LED, former nos employés aux éco-gestes, ou établir un code éthique fournisseur), il faut le faire savoir à nos clients et partenaires. Présenter une carte d’identité RSE de notre entreprise, actualisée chaque année, peut par exemple être une bonne pratique. Cela montrera que nous prenons le sujet au sérieux et que nous avançons dans la bonne direction, ce qui sera apprécié et potentiellement exigé demain.
En conclusion, la taxonomie verte de l’UE n’est pas juste une énième contrainte réglementaire pour les grands groupes : c’est une tendance de fond qui redéfinit progressivement les règles du jeu économique autour de la durabilité. En tant que PME, nous avons tout intérêt à nous saisir du sujet dès aujourd’hui. Cela ne signifie pas transformer du jour au lendemain toutes nos opérations, mais commencer à intégrer l’esprit de la taxonomie dans notre gestion quotidienne. Les bénéfices sont multiples : répondre aux attentes de nos clients clés, accéder plus facilement à des financements, gagner des points dans les appels d’offres, motiver nos équipes autour d’un projet d’entreprise durable, et tout simplement assurer la pérennité de notre activité dans un monde qui se veut “net zéro” en 2050. Préparons-nous pas à pas, armés de transparence et de bon sens, afin que le moment venu, nous puissions dire : « Nous aussi, nous contribuons à la transition verte, et nous le prouvons ! »